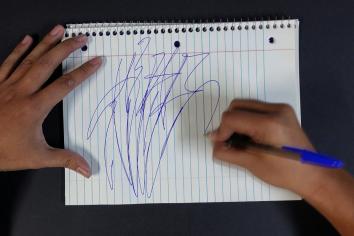- Les directes : celles produites par l’école, comme les voyages en avion des étudiants en échange par exemple ou les allers retours avec le véhicule de l’école.
- Les indirectes liées à l’énergie : électricité, chauffage, climatisation…
- Toutes les autres indirectes : alimentation, trajets pour venir à l’école, transport des matériaux pour les projets, etc.
La grande leçon ? Tout compte. Déplacements, achats, nourriture, énergie du bâtiment, gestion des déchets…
Aucun poste n’est négligeable, et si on veut réduire notre impact, il va falloir s’attaquer à tout, sans exception. - Les achats qui comptent pour 25% de notre bilan carbone : entre matières premières pour les projets, fournitures d’ateliers et prestations de service, c’est le plus gros poste d’émissions.
- L’alimentation qui pèse pour un peu plus de 20% du bilan total : malgré 50% de repas végés consommés par les différentes communautés de l’école le midi*, la viande rouge (seulement 20% des repas) représente 65% des émissions. Rien de surprenant même si on peut le rappeler : les bovins émettent du méthane, nécessitent un espace agricole important et sont en plus nourris avec des céréales qui sont produits et transportés souvent sur de grandes distances.
- Les déplacements (13%) : l’avion est encore trop utilisé, notamment pour les échanges. On pourrait largement s’améliorer sur ce plan.
- La climatisation : utilisée peu souvent, elle est pourtant ultra polluante à cause des fluides frigorigènes, qui ont un effet jusqu’à 1000 fois plus réchauffant que le CO².
- Les déchets : 140 kg par personne chaque année, entre emballages, restes de matériaux et déchets d’ateliers qui finissent souvent à la benne.
- L’énergie des bâtiments : malgré une utilisation du réseau de chaleur parisien à 50% d’énergies renouvelables (géothermie, biomasse etc.), notre consommation électrique équivaut encore à 148 tonnes de CO² par an.
- Optimiser la consommation du bâtiment : On va poursuivre et renforcer nos actions de réduction des consommations du bâtiment. On va finir le relamping LED, puis on s’attaque à mettre en place ce qu’on appelle une GTB (Gestion technique du bâtiment) qui nous permettra de réguler l’éclairage, le chauffage, la climatisation et la ventilation en fonction des besoins réels. On se donne aussi comme objectif d’installer des panneaux photovoltaïques sur la toiture orientée sud.
- Mieux gérer les déchets : création d’une récupérathèque pour favoriser le réemploi des matériaux dans les ateliers et les projets étudiants. Certains enseignants intègrent déjà cet aspect dans l’évaluation des travaux.
- Sensibiliser à l’impact énorme de l’alimentation sur le réchauffement planétaire : l’idée, c’est d’introduire une offre végé-végan attractive. Si on divise par deux les repas carnés, on peut réduire les émissions de l’école de 6%.
- Limiter l’impact du numérique : On veut favoriser la sobriété numérique. Prolonger la durée de vie des équipements, éviter le gaspillage. Le numérique, s’il était un pays, serait le 5ᵉ plus gros consommateur d’énergie au monde, l’école doit faire sa part du boulot en optimisant le plus possible tout en continuant de proposer aux étudiants les outils qui leur permettent de se former correctement. La chance de l’école c’est que le LAN – Laboratoire d’Artisanat Numérique - et le méridien numérique apportent énormément à la réflexion sur le numérique.
- Réformer nos achats : privilégier systématiquement des fournisseurs écoresponsables et intégrer des clauses environnementales dans tous nos marchés publics.
Depuis 2019, l’École des Arts Décoratifs-PSL s’affirme comme un acteur engagé de la transition écologique, sociale et solidaire. Elle fédère étudiants, enseignants et personnels autour d’un projet ambitieux : imaginer des formes soutenables et replacer la création au service du bien commun.
Simon Vialle, pilote la politique de transformation écologique, sociale et solidaire au sein de l’école et nous parle de sa mission et décrypte dans cet entretien les enseignements de notre bilan carbone récemment paru, et dont découle un plan d’action pour les années à venir.
Quel est ton rôle et d’où vient ton engagement dans cette “Ecole de la Transformation” ?
Je travaille à l’école depuis la rentrée 2022 avec l’équipe de direction et entre autres missions je suis chargé de piloter la transformation écologique, sociale et solidaire de l’école. C’est un poste qui n’a pas toujours existé à l’école. L’approche que nous avons de cette transformation dépasse la seule mise en place d’un plan de transition écologique. Car penser une école engagée aujourd’hui, c’est articuler des sujets différents, comme l’égalité femme-homme au travail, la lutte contre les discriminations et les VHSS, l’enseignement des travaux menés sur les questions décoloniales ou de genre, c’est aussi questionner les systèmes numériques fermés, etc. C’est aussi et surtout refuser de hiérarchiser ces sujets et reconnaître que toute transformation écologique ne peut être dissociée d’une transformation sociale et politique.
Précédemment, j’ai travaillé plusieurs années pour l’univers du livre et de l’édition au ministère de la Culture à soutenir les librairies indépendantes et à faire vivre la loi sur le prix unique du livre qui garantit en France la diversité éditoriale et la vie littéraire. Personnellement, je suis convaincu que la culture – qu’elle soit écrite, visuelle ou performée – est cruciale pour développer une pensée critique et un récit collectif alternatif. Art et politique sont intimement liés, c’est presque une banalité de dire cela.
Face aux grands enjeux actuels – climat, égalité, solidarité –, la culture formule la critique générale, nécessaire au changement. Elle formule les grandes questions auxquelles on doit répondre pour agir.
D’ailleurs, en librairie, vous verrez que de nombreux livres traitant d’écologie, de militantisme ou de transformation sociale ont pour titre de simples questions : Comment atterrir ? de Bruno Latour, Comment saboter un pipeline d’Andreas Malm, Comment bifurquer de Cédric Durand et Razmig Keucheyan …
Ça en dit long. L’essentiel, c’est de se poser des questions. Et si une école a un rôle clé, c’est bien celui-là : apprendre à interroger et à se poser des questions. L’École des Arts Décoratifs-PSL est un espace où naissent les questions, où elles se travaillent, s’affinent, s’entrechoquent. C’était à mon avis un bon endroit pour parler de transformation.
Au sujet du bilan carbone de l’école : dans quel contexte s’inscrit-t-il, quel était son objectif ?
C’est dans cet état d’esprit, parce que nous avions beaucoup de questions sans réponse - Combien de CO² émettons-nous ? Combien de tonnes matériaux jetons-nous par an ? Comment réduire notre consommation d’énergie ? - que nous avons réalisé l’an dernier, en collaboration avec le cabinet de conseil en transition écologique Auxilia-Mutans, un bilan carbone de l’école.
Ce bilan s’inscrit dans un cadre particulier. Reconnue comme étant particulièrement active en matière de transition écologique, le ministère de la Culture a choisi l’École des Arts Décoratifs-PSL pour piloter les bilans carbones des 10 écoles nationales supérieures d’art visuel. La mission est désormais terminée, et chaque école dispose d’un bilan personnalisé ainsi que d’une feuille de route pour réduire l’empreinte carbone de l’enseignement en art et design en France.
Le bilan spécifique de notre école a révélé plusieurs enseignements importants. L’enjeu, c’était d’identifier où et comment agir et de passer à l’action, sans attendre. Et l’objectif, de veiller à ce que cela se traduise en actions concrètes et mesurables.
En termes de méthodologie, nous avons a pris en compte trois types d’émissions :

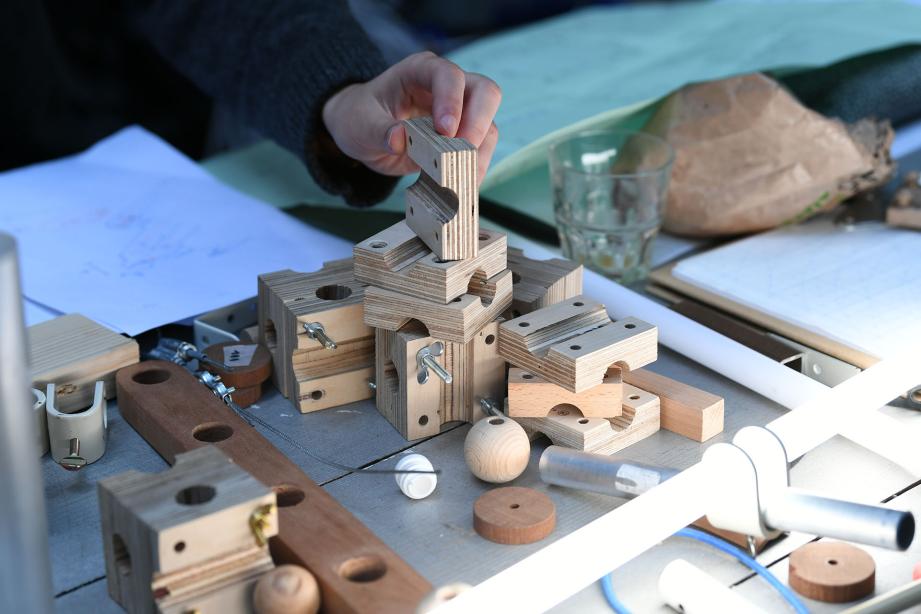
Dans le détail, quels sont les enseignements de ce bilan carbone ?
Les postes d’émissions les plus significatifs dans notre établissement sont :
“Grâce à ce bilan, on sait précisément où agir, et on s'est fixé un objectif clair : réduire notre empreinte carbone de 15% d’ici 2030.”
Quel est le plan d’actions qui en découle ?
Sans attendre ce bilan carbone, depuis plusieurs années, la direction technique travaille à rendre le bâtiment plus économe en énergie. Par exemple, plus de 500 ampoules LED remplacent progressivement l’éclairage existant, avec un impact non négligeable sur la consommation.
Mais grâce à ce bilan, on sait précisément où agir, et on s'est fixé un objectif clair : réduire notre empreinte carbone de 15% d’ici 2030. Les grandes lignes de notre plan d’action sont :

Pour conclure sur ce plan d’action, quel est le principal défi qui attend l’école ?
Pour l’école en tant que lieu, le principal défi est de rendre à la fois le bâtiment et l’activité générale plus sobre en consommation d’énergie.
Avec le projet d'extension immobilière, on va déjà faire un saut important : pas de système de climatisation, des matériaux durables, un réemploi important des matériaux de l’ancien bâtiment. C’est une belle signature pour l’ambition générale d’une école des arts écologiques.
Mais je dirais en conclusion que l’école a une responsabilité qui prime : celle de former des créateurs, artistes et professionnels qui puissent transformer les filières dans lesquelles ils ont vocation à s’insérer pour qu’elles-mêmes soient plus durables.